|
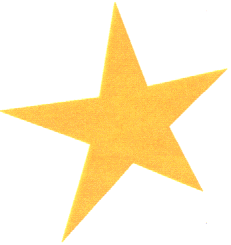
| |
Economie(s) islamiques.
Essai d’élucidation du concept
Qu’est-ce qu’une économie islamique ? Le terme peut revêtir trois sens. Il peut s’agir, en premier lieu, des préceptes que l’Islam pose pour réglementer les rapports économiques. En second lieu, s’agissant de la discipline dénommée « science économique », ce terme viserait l’apport à la compréhension des phénomènes que nous dénommons « économiques » qu’auraient pu faire des penseurs islamiques. En troisième lieu ce même terme peut viser les systèmes économiques réels des pays qui , aujourd’hui comme hier, se sont proclamés islamiques. Nous envisagerons successivement les trois sens du mot.
1) L’éthique économique de l’islam
Les sources de cette éthique sont d’une part le Coran , d’autre part la Sunna, ensemble des Hadites, rapportant toutes les actions et paroles du Prophète, que tout musulman doit s’efforcer d’imiter. Mais ni le Coran ni la Sunna ne pouvant prévoir toutes le situations futures , il revient à la Communauté , Ijmaâ , par la voix de ses juristes à poser les principes complémentaires ; en fait ce sont les docteurs de l’ Islam qui, par leurs «effort personnel » , l’Ijtijad, posent ces nouveaux principes au nom de la Communauté. En ce sens l’Islam ne diffère guère des deux autres religions du Livre. Ce sont les Conciles qui ont interprété les Evangiles, et la Torrah qui complète la Bible.
Cependant le contenu « économique » (au sens moderne) de ces textes divers est assez réduit. C’est que l’Islam s’est installé au Proche-Orient puis dans le sud de l’ Europe, à une époque, comme nous le verrons plus loin , ou les rapports économiques étaient indistincts des rapports politiques . Les principes d’organisation de ces derniers constituaient encore, comme au temps des grecs , l’essentiel de la « morale appliquée ».
S’agissant de la propriété , l’Islam enseigne que Dieu seul est propriétaire éminent ( mulk, le « haut domaine ») des choses , mais il a fait de l’homme son khalifa, son représentant sur terre. Usufruitier en quelque sorte ! A l’époque du Coran l’activité principale est l’activité agro-pastorale. La Terre donne ses fruits du fait du soleil et de la pluie ( donc de la volonté de Dieu) et du travail des hommes. Tous les hommes sont au fond dans l’indivision , mais chacun exploite une part de cette terre. Il en est « possesseur » plus que propriétaire. Ce n’est pas le fait qu’il travaille cette terre qui ouvre son droit de propriété . Ce sont les signes que Dieu l’a voulu ainsi ; il l’exploite parce qu’il l’a héritée, ou qu’il l’a conquise, deux évènements qui dépendent de la volonté de Dieu. Dés lors qu’il est possesseur, il ne peut plus être dépossédé. L’Islam garantit donc, sous les limite susdites, un droit de « propriété ». Y porter atteinte est une désobéissance à Dieu.
Ne pas croire , pour autant , comme on le dit quelquefois, que l’Islam prône la soumission au hasard, qu’il incite au fatalisme. C’est à la volonté d’Allah que l’homme doit être soumis, ce qui ne l’empêche pas de devoir travailler à sa propre subsistance. Comme le souligne Ghany Gaussy : the Prophet pilloried the fatalims ou pre-islamic ideology and he explained earthly phenomena as the product of interaction between heavenly and human activity.De même, un autre commentateur , cité par la même source ,Cahen précise que “le fatalisme au sens du pouvoir qui conduit l’homme à la passivité, est étranger à l’essence de l’Islam »
Pour poursuivre sur le thème de la propriété , dans l’héritage, les filles reçoivent la moitié de la part de l’homme , mais le Coran a prévu plus de détail encore pour l’héritage , montrant bien par là que l’importance sacrée de la possession attribuée par Dieu dont le signe est l’héritage. Par ailleurs l’homme est vivement encouragé à « immobiliser » ( waqafa opu habasa)) une partie de ses biens au profit d’œuvres pieuses, qui en recueilleront l’usufruit. Ce sont les biens habous.
Concernant l’usufruit, on distinguera , par la suite, comme on le voit dans Ibn Khaldoun que nous utiliserons abondamment plus loin, la subsistance, rizq, qui pourrait être le minimum vital , et auquel Dieu pourvoit , mais qui l’exclut pas, selon ce qui a été dit plus haut, un minimum de travail de l’homme, du «gagne pain »( ma’âsh), qui , lui, en implique clairement une « dose »importante . Ce travail peut apporter des « profits » ( makâsib), et si ceux –ci sont supérieurs à ce sont l’homme a besoin, ils vont constituer son« fonds »(riyâsh) ou son capital (mutamawwil).
Ibn Khaldoun n’est pas un « docteur » de la loi, même s’il fut professeur de droit malikite à Tunis, puis cadi. . C’est d’abord un chroniqueur génial . De plus il écrit 1377 , époque à laquelle les arabes ont développé une économie prospère , notamment en Andalousie, très différente de celle du VII ème siècle . Mais malgré ses réserves on peut considérer avec lui que l’Islam distingue la subsistance , que tout homme reçoit de la bonté divine, et qui n’exige que peu de travail de sa part, du profit – nous dirions revenu- qu’il tire d’un travail supérieur au minimum nécessaire pour « cueillir » la subsistance.
Mais l’homme n’a droit à cette subsistance et , au delà à son profit, que s’il pratique l’aumône légale , la « Zakkate », collectée par le pouvoir politique et redistribuée par lui aux nécessiteux, aux captifs , à ceux qui sont chargés de dettes, aux voyageurs, mais aussi utilisée pour soutenir la guerre sainte. Dans une société agro-pastorale d’autoconsommation familiale, dans laquelle le dirigeant est lui même agriculteur ou pasteur, la Zakkate est donc un impôt - son prélèvement obligatoire est fait selon le Coran- mais prédestiné à la redistribution. Il traduit le souci égalitariste de l’Islam, son désir que soit traduite dans les rapports économiques , l’égalité stricte de tous les croyants devant Dieu. On comprend aisément que la Zakkate ait pu être ensuite dévoyée au fur et à mesure que des appareils d’Etat coûteux , menant la guerre de conquête , se sont développés. La Zakkate n’est ,bien sûr, pas exclusive de l’aumône facultative à laquelle le musulman est vivement encouragé .
Par contre le profit ne saurait provenir de l’usure,(« riba ») c’est –à-dire du prêt à intérêt. L’Islam comme la religion chrétienne initiale le prohibe . L’intérêt c’est le prix du temps et le temps appartient à Dieu seul ; on ne saurait donc en tirer profit. C’est , dit sous une autre forme le vieux principe aristotélicien : « pecunia non parte pecuniam ». Mais alors que , progressivement , de St Thomas à Calvin, la religion chrétienne a mis en accord sa « lettre » avec la pratique, en autorisant finalement le prêt à intérêt ( l’intérêt étant interprété comme la rémunération de l’abstinence du prêteur ou de l’épargnant), la religion musulmane y est restée fidèle. La lettre de change elle-même est généralement désapprouvée sinon interdite.
Paradoxalement , cependant, le Livre fixe avec précisions les conditions d’octroi d’un prêt ( évidemment sans intérêt) : le principe de l’écrit par un scribe avec deux témoins, un tuteur pour l’incapable…De plus, prohibant l’intérêt le Coran encourage à l’épargne, et condamne prodigalité et dissipation des richesses .
Selon certains docteurs particulièrement sévères étaient aussi interdit le métayage ( muzaraâ) et la commandite( moudaraba) , car il s’agit , au fond , d’un pari assimilable au jeu de hasard. Mais, par la force des choses cet interdit là sera rapidement ignoré car , le prêt à intérêt étant interdit, il bloquait toute forme de financement collectif , toute société de capitaux
On peut déduire aussi des fondements de l’Islam que l’assurance est interdite. Seul Dieu est maître d’un destin que l’homme doit accepter. Il ne saurait donc « échanger » ce destin contre de l’argent. Certains ont d’ailleurs fait remarquer que le terme « risk » est probablement à l’origine du mot « risque » en français, indiquant bien que la subsistance fournie par Dieu peut varier selon Sa volonté, que les hommes dénomment « hasard » et auquel ils doivent se soumettre sans tenter d’en pallier d’une façon ou d’une autre les effets
Reste enfin la question du bénéfice commercial. Mahomet est issu de Médine , ville commerçante par essence. Il ne pouvait donc pas ignorer le commerce. Or il est étrangement silencieux sur le bénéfice commercial. Par la suite la Sunna a avancé le principe que les forces des échangistes devaient être équilibré : est prohibé le bénéfice qui résulterait d’une domination de l’un des échangiste sur l’autre.
devait être. Ceci peut évidemment être étendu au rapport salarial.
Sept siècles plus tard, Ibn Khaldoun nous dit que, pour former « la marge entre le prix d’achat et le prix de vente , la loi religieuse permet « « quelque astuce » » , en dépit de la part de jeu que cela comporte parce que le commerce, , après tout, ne consiste pas à prendre sans compensation le bien d’autrui » . Prudent il ajoute toutefois : « Mais Dieu en sait plus long la dessus » , laissant chacun face à sa conscience pour la marge qu’il prélève…On retrouve, plus imprécise encore , le concept très mal précisé de « juste prix » avancé en 1200 par St Thomas d’Aquin, témoin lui aussi du développement des échanges marchands.
Enfin , bien entendu, est prohibé le commerce , comme la consommation, des produits interdits comme le porc, l’alcool ou les jeux de hasard.
Telle est , très brièvement exposé , l’éthique de l’Islam sur les rapports économiques. Avant de voir l’application qui en est faite aujourd’hui, il convient d’analyser tout aussi brièvement le regard « laïc »des auteurs musulmans sur les rapports économiques , la description qu’ils en font.
2)Le monde économique vu par les musulmans
Il n’est pas question ici des théories et apports des économistes modernes de religion musulmane, formées aux doctrines économiques modernes exposées depuis le XVIII ème siècle. Cette étude pourrait présenter un grand intérêt, mais n’a pas sa place ici. Ce qu’on vise , c’est la description de l’économie du monde arabe dans le passé par les chroniqueurs contemporains musulmans, qui , tout comme leurs homologues européens , ont découvert l’économie marchande à partir du XI ème siècle environ , tant dans le Machrek, dans les grandes métropoles abbassides de Damas et Bagdad qu’au Maghreb et en Andalousie. Toutefois, nous nous limiterons, comme annoncé, au plus célèbre d’entre eux, Ibn Khaldoun.
Dans son « Discours sur l’Histoire universelle intitulé , il étudie toute une série de catégories économiques et dégage des principes d’une étonnante modernité.
Ibn Khaldoun décrit d’abord dans « Les moyens de gagner sa vie » , les diverses activités économiques , agricoles, artisanales , commerciales et intellectuelles. Il explique l’apparition plus tardive parce qu’urbaines des trois dernières . Il souligne, par contre , que vivre des prélèvements fiscaux, comme le font les dirigeants politiques, n’est pas un moyen « naturel » de gagner sa vie . Pas plus d’ailleurs que d’être « serviteur » ! . Ibn Khaldoun commet ici la même erreur que commettront les économistes classiques et à leur suite les marxistes en considérant comme non productifs les services domestiques ;il les décrit lui aussi comme rétrocessionnaires du gain de ceux qui les emploient. Biais théorique clairement lié à la rémanence d’une vision féodale de l’organisation sociale !
Plus loin il décrit les divers modes de gain dans le commerce : stockage et spéculation- en soulignant évidemment le risque de tout perdre inhérent à celle-ci - , recherche des lieux ou l’offre est plus faible et prodigue des conseils très pertinents pour le commerce lointain . Plus loin encore traitant du « Bon marché » il a l’intuition assez précise du jeu des prix sur la répartition de ce que nous appelons les revenus.
Lumineuse est la description qu’il fait dans « Considération vaut richesse » du contraste entre l’accumulation par captation du noble, tirant profit de ses rapports politique dominants et du simple acteur économique , du « marchand » qui « ne gagne davantage qu’en proportion de ses efforts ». Plus loin il décrit aussi avec pertinence la nécessité de contraindre les hommes à la solidarité , car ils s’y soustrairaient volontiers, afin de maintenir la société elle-même.
Poussant plus loin l’analyse du « mécanisme des impôts » Ibn Khaldoun fait-il la description très lucide du développement de l’Etat, de ses coûts puis du prélèvement et finalement de l’effet négatif sur ce qu’il appelle le « revenu national » . Comme celui-ci « provient en majorité des cultivateurs et des marchands surtout après l’introduction de la taxe sur les transactions commerciales, une fois que le paysan a délaissé ses champs et que le négociant a fermé boutique , les recettes fiscales s’évaporent ou baisent dangereusement » . Et plus encore :
« à la fin d’une dynastie les taxes sont devenues démesurées , les affaires ne marchent plus faute d’espoir de profit et la civilisation décline. Tout cela va de mal en pis jusqu’à la disparition de
l’Empire » . Les méfaits de la sur-taxation que vont décrire, trois siècles plus tard, Vauban , l’effet économique de l’impôt que décrira Keynes encore deux siècles plus tard et finalement la loi de Lafer , sont déjà aperçus assez clairement par le chroniqueur tunisien.
De même Ibn Khaldoun fait-il une description de la différence entre monnaie de compte et monnaie réelle, les deux coexistants à la même époque et pour la même raison- la frappe multiple et les manipulations monétaires- dans les pays musulmans et dans les pays européens.
Bref , Ibn Khaldoun décrit avec lucidité les rapports économique qu’il voit se constituer notamment dans l’Andalousie musulmane qui est alors devenue le centre « économique « et culturel le plus important du monde arabe. Il n’est pas le seul chroniqueur à s’être ainsi attaché à cet aspect de la société. Mais il est sans doute le plus notable. Et il est en avance d’un certain point de vue sur les premiers « économistes européens qui, avec les mercantilistes ne feront leur apparition que deux siècles plus tard. C’est que le monde arabe dispose alors d’une économie marchande, certes strictement soumise au politique et au religieux, mais plus dynamique et diversifiées que celle de l’ Europe à laquelle elle fournit d’ailleurs les marchandises à partir de laquelle celle-ci va à son tour se développer et susciter l’étude des mercantiliste. Cependant, ni dans le monde arabe, ni en Europe , les rapports économiques ne sont alors distincts des rapports politiques . Les rapports économiques que nous distinguons clairement , sont donc étudiés par tous les auteurs, chrétiens comme musulmans à travers, ou au moins, « au milieu » des rapports politiques. Le livre d’Ibn Khaldoun – comme les autres chroniques- est de ce fait principalement un livre d’histoire et de « science politique » . Il accorde cependant aux catégories que nous dénommons aujourd’hui « économiques » une place plus importante que les autres et un regard assez perçant.
Tout différent sera , sept siècles plus tard, le regard que les économistes des pays « développés », avec leurs concepts nouveaux, vont jeter sur les économies concrètes des pays musulmans modernes.
3) L’Islam et les économies des pays musulmans d’aujourd’hui.
Ce regard s’est organisé , après la guerre , sur le concept de sous-développement. En effet, depuis 1492 et l’effondrement – sous les coups des Castillans et de ses propres dissensions internes- du Khalifat de Grenade, la « civilisation islamo-arabe « n’ a cessé de reculer faisant en quelque sorte le chemin inverse de sa conquête du VII ème siècle. A l’ouest les chrétiens à partir d’Espagne et de la bataille de Lépante reconquirent peu à peu la méditerranée, reconquête achevée avec la colonisation du maghreb. A l’est les turcs soumirent les dynasties arabes locales, maintenant l’islam dans le « croissant » allant des Balkans à l’Algérie, bloqué cependant par les Russes et les austro-hongrois ; mais la « Sublime Porte s’effondra a son tour en 1918, abandonnant les Balkans à l’anarchie puis à la chape soviétique et le sud du « croissant » au colonialisme européen.
Ce recul politique s’accompagna d’un recul économique relatif. Tandis que la révolution industrielle se développait en Europe puis aux Etats-Unis, les pays musulmans subissaient, comme les autres colonies, l’échange inégal, ou la « dialectique de la dépendance ». L’agriculture y fut, pour partie, extravertie en grandes propriétés tournées vers les exportations, pour partie maintenue en auto-consommation sous-productive, tandis que les circuits commerciaux traditionnels qui en écoulaient les produits, étaient court-circuités ou pénétrés par le commerce et les produits européens. Les seules industries installées par les européens furent celles qui transformaient les matières premières locales à destination principale de l’exportation. Seuls quelques élites locales traditionnelles furent en quelque sorte sélectionnées ou tolérées pour entrer dans le commerce « moderne » ou les professions libérales. De sorte que le problème de la compatibilité entre l’économie moderne et l’islam ne fut même pas posé. Dans les pays féodaux du Golfe, indépendants, mais soumis eux aussi à l’exploitation à prix réduits de leur pétrole , l’utilisation capitaliste des recettes pétrolières, juste suffisante pour l’entretien des dynasties, ne posa pas ce problème.
La première condition pour qu’il puisse se poser était la décolonisation et la prise en mains des diverses activités économiques – industries , banques commerces- par des nationaux musulmans.
Cependant , sitôt après la décolonisation, dans les années cinquante/soixante, s’installèrent, dans un certain nombre de pays musulmans dans les années cinquante/ soixante , des systèmes politiques et /ou économiques copiés sur le système soviétique avec nationalisation au moins partielle des industries et banques, planification , coopération agricole obligatoire, primat à l’industrie lourde…. L’idéologie marxiste qui inspirait ces politiques était portée par les élites qui avaient fait leurs études en Europe ou ces idées constituaient elles mêmes la base théorique des partis de gauche qui avaient été favorables aux indépendances. Assez vite ces politiques montrèrent leurs limites avec sous-production générale , appauvrissement des populations, dépendance accrue des importations alimentaires, ce qui amena un à un les divers gouvernements à revenir vers l’économie marchande. L’Algérie, qui disposait de la manne pétrolière , put , malheureusement pour elle, poursuivre plus longtemps dans cette impasse.
Cette parenthèse prolongeât l’occultation de la question de la compatibilité des dogmes de l’Islam avec l’économie marchande développée. La solidarité prônée par l’ Islam s’accommodaient fort bien des dogmes « communistes ». L’idée même que le « centre » pouvait tout organiser et que chaque citoyen recevrait de quoi satisfaire ses besoins s’accommodaient aussi assez bien , au moins formellement, avec l’idée que Dieu pourvoit à l’entretien des « adhérents ». Même si l’Islam est totalement incompatible avec le matérialisme dialectique, les méfaits de la colonisation fondaient l’acceptation du matérialisme historique et conduisaient à accepter facilement le modèle économique soviétique.
Mais une fois la parenthèse refermée , les nouveaux dirigeants furent effectivement confrontés à cette question : nos activités économiques sont-elles compatibles avec l’Islam ? Du moins la question leur était-elle posée plus ou moins discrètement selon les pays. Beaucoup plus discrètement au Maghreb qu’au Machrek et plus fortement en Arabie saoudite, qu’au Liban. Dans les pays du Golfe elle fut posée avec plus d’acuité car ces pays devinrent alors des « rentiers » du pétrole , avec une masse de « pétro-dollars » à investir ou placer.
La « réponse » des décideurs économiques , puis des décideurs politiques, une fois abandonné le « modèle » soviétique, fut , en général, totalement tacite, et son principe fondateur implicite fut celui-ci: « si nous voulons , pour le bien de nos peuples , jouir de la modernité et entrer dans le marché mondial , nous devons imiter l’organisation économique des euro-américains ». Et c’est ce qu’ils firent. S’agissant du commerce et de l’organisation économique , rien ne permet depuis 20 ans environ , au moins formellement, de distinguer les entreprises marocaines, tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes, de leurs homologues euro-américaines. Nous n’avons pas mentionné les entreprises irakiennes, syriennes, lybiennes et algériennes parce que, dans les pays correspondants , un pouvoir politique puissant exerce encore une très forte domination sur le système économique qui n’a pas encore l’autonomie minimale. Même en Iran , ou la Charia est censée être appliquée avec rigueur, c’est dans le domaine de l’organisation économique qu’elle est la moins sensible.
On pouvait penser, par exemple, que les relations salariales au sein des entreprises dirigés par des musulmans et établies dans des pays dont les constitutions et les gouvernements font référence à l’islam, seraient sensiblement différentes de ce qu’elles sont dans les pays développés : peut-être les préceptes de partage auraient-ils du entraîner un plus grand souci d’égalité dans la distribution primaire des revenus. Il n’en est rien. Soumises à la même compétition, aux mêmes nécessités d’investir, les directions de ces entreprises ont établi un partage de la valeur ajoutée identique à celui qui prévalait , à niveau de développement égal, dans les pays développés. Les salaires sont, par rapport aux salaires européens dans la même proportion que les PIB. Si l’on constate au Maghreb , une propension plus forte à la négociation sociale et aux avantages sociaux , c’est probablement plus du fait de l’influence de la législation française…
En dehors de la sous-productivité relative du mois de Ramadan , et de la projection dans l’entreprise , de la « valence différentielle » des femmes- bien qu’on trouve de plus en plus de femmes cadres et chefs d’entreprise au Maghreb-, rien ne distingue vraiment les entreprises de ces deux parties du monde.
Deux spécificités peuvent cependant être notées dans les pays musulmans. En premier lieu, peut-être, un moindre développement de l’assurance, qui va au delà de celui imputable au seul retard de développement, et qui est peut-être lié à l’éthique islamique.
En second lieu un « secteur » du système financier qui , dans les pays du Golfe et en Arabie saoudite, s’affiche « islamique » et sur lequel nous conclurons.
Dans tous les pays concernés existe un système bancaire classique , en général « hérité » de la colonisation ou de la domination européenne, qui pratique l’intérêt dans la rémunération de ses dépôts comme dans l’octroi de ses emprunts. Nous sommes là en présence d’une contravention avec un principe islamique fondamental, qui ne pose apparemment pas de problèmes religieux aux dirigeants de banque et dirigeants politiques . Le même principe, lorsqu’il était en vigueur dans la chrétienté , avait été tout aussi transgressé sans vergogne. Il est vrai que l’on peut, comme indiqué plus haut , trouver au versement ou au prélèvement d’un intérêt , une justification : la rémunération de l’abstinence de l’épargnant, qui absout la pratique du péché de valorisation du temps.
Toutefois, un certain nombre de financiers islamiques ont voulu mieux accorder leur pratique avec les préceptes du Coran . Dans leurs banques « islamiques » , par conséquent les prêts prennent trois formes qui répondent à cette nécessité .La première est la « moudaraba » ou commandite , déjà évoquée, tolérée par certains docteurs de l’islam, dans laquelle la banque est considérée comme commanditaire, et recueille donc une part des bénéfices au terme de l’opération qu’elle a financée. Le second contrat est la « musharaka »dans lequel un entrepreneur ayant un besoin de financement appelle une banque en co-finacement et cogérance avec lui, le prélèvement du banquier se faisant progressivement sur les recettes. Enfin la banque peut masquer un financement court pour stocks, par le contrat « morabaha », en achetant elle-même les marchandises à stocker et en les revendant avec marge à l’entreprise qui les utilise.
Par ailleurs les banques islamiques peuvent pratiquer sans aucune restriction , le crédit-bail, ou « ijara waiktina » puisque le client paye par des loyers les machines ou bâtiments dont il a besoin et dont il n’est pas propriétaire.
Précisons immédiatement que cette formalisation de contrats de financement bancaire est limités à certains établissements et qu’il est probable que , peu à peu , les docteurs de la Loi, mettront l’interprétation du Livre en accord avec la réalité économique comme ce fut le cas vis à vis de la religion chrétienne.
Il convient toutefois de remarquer que, du fait de son rejet de l’intérêt, l’Islam privilégie au moins par défaut, le financement de marché par rapport au financement bancaire. Ceci devrait être un facteur stimulant pour les Bourses de ces pays . Malheureusement , ces bourses qui ont été modernisées pour répondre aux exigences des apporteurs étrangers de capitaux, et gonflées durant quelques années par les privatisations, ce qui a d’ailleurs été le fondement du qualificatif « émergents » attribué comme un « diplôme » à ces pays, s’avèrent assez peu abondées par les capitaux nationaux , leurs détenteurs semblant avoir une aversion pour le risque au moins égale à celle des capitalistes chrétiens ou juifs, en tous cas bien plus élevée que celle des asiatiques.
A moins que les promoteurs des bourses des pays d’Islam n’aient pas encore trouvé les moyens et arguments pertinents pour exploiter cette virtualité de l’éthique islamique ?
Monsieur le Professeur Jean Matouk
Professeur d’Université honoraire
Nîmes- décembre 2000
Auteur de nombreux ouvrages
en anthropologie économique
Courrier électronique: matouk@lkac.gulliver.fr
|

![]()